
Résidus, valeurs limites, confiance – regarder les faits derrière les gros titres
Dans cet entretien avec le toxicologue Lothar Aicher, il est question de la manière dont les résidus sont absorbés par l’organisme, de l’évaluation de leur dangerosité et du rôle que joue l’analytique moderne.
lundi 17 novembre 2025
« Les produits phytosanitaires font partie, avec les médicaments, des substances les mieux étudiées », rappelle l’épisode – et pourtant, le débat public reste souvent superficiel. Bien trop souvent, ce sont les dépassements de valeurs limites et les accusations qui dominent, tandis que la complexité des interactions entre politique, recherche et pratiques agricoles est largement ignorée.
Aicher explique non seulement comment les résidus pénètrent dans l’organisme par les aliments, la peau ou la respiration, mais aussi comment le corps les métabolise et quels processus biologiques de dégradation interviennent.
Le podcast invite à un débat plus objectif : il ne s’agit pas de susciter des peurs, mais d’expliquer comment les valeurs limites sont établies, à quoi elles servent, quelles incertitudes existent et comment les risques sont évalués de manière réaliste. Les consommateurs absorbent généralement de très petites quantités ; le risque découle de la toxicité d’une substance, de la quantité absorbée et de la fréquence de l’exposition.
Aperçu de toute la série Agrarpolitik – le podcast avec swiss-food
Le podcast Agrarpolitik et swiss-food.ch examinent dans une série commune comment la Suisse gère les risques, les valeurs mesurées et la perception des produits chimiques – de manière factuelle, compréhensible et proche de la pratique.
Le point d’orgue de la série a été l’événement en direct au Bogen F à Zurich.
Épisodes :
Épisode 1 avec la Dre Angela Bearth (Écouter l’épisode, traduit avec IA)
Épisode 2 avec le Dr Lothar Aicher (Écouter l’épisode, traduit avec IA)
Épisode 3 avec le Dr Michael Beer (Écouter l’épisode, traduit avec IA)
Épisode 4 avec Christine Badertscher (Écouter l’épisode, traduit avec IA)
Aicher décrit également comment la dangerosité d’une substance chimique est déterminée : elle repose sur des études toxicologiques contrôlées – souvent des essais sur animaux –, dont les résultats sont intégrés dans des facteurs de sécurité définis par la loi. Il explique aussi pourquoi les alternatives aux tests sur animaux prennent de plus en plus d’importance, tant du point de vue éthique que scientifique.
La question de la réduction des risques liés aux résidus est également abordée : grâce à de bonnes pratiques agricoles, à une application correcte et à des contrôles efficaces. Ce n’est qu’en communiquant clairement ces éléments que la confiance et un dialogue constructif peuvent émerger – conditions essentielles pour une compréhension mutuelle et des solutions pragmatiques dans la réglementation des produits chimiques et la protection des plantes. Un autre thème clé de l’épisode concerne les PFAS : Aicher explique pourquoi il est nécessaire de réduire ou de remplacer ces substances.
L’épisode montre également que les discussions publiques sont souvent émotionnelles, alors même que l’évaluation scientifique est solide. Aicher illustre pourquoi nous évaluons parfois mal les dangers – et souligne : « Nous avons tendance à sous-estimer les risques lorsque nous y voyons un avantage personnel. » Il rappelle ainsi que l’alcool est indéniablement un poison – en particulier lorsqu’il est consommé en grandes quantités. Une chose est claire : comprendre les mécanismes derrière les valeurs limites et les évaluations des risques permet de porter un jugement plus nuancé et de favoriser un débat fondé sur les faits.
Veuillez noter :
Notre équipe éditoriale n'est pas de langue maternelle française. Bien que nous accordons une grande importance à une communication claire et sans faille, parfois nous devons privilégier la rapidité à la perfection. Pour cette raison, ce texte a été traduit à la machine.
Nous nous excusons pour toute erreur de style ou d'orthographe.
Articles similaires

Des scientifiques appellent à la raison
Le deuxième entretien swiss food avec les médias a réuni trois experts de renommée internationale, issus des domaines de la toxicologie, de la protection des eaux et de la sécurité des denrées alimentaires. Les scientifiques plaident pour plus d’objectivité.
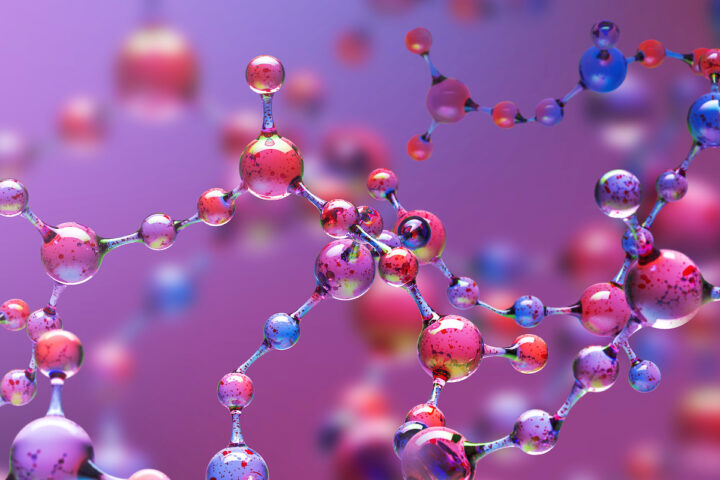
De la molécule au produit phytosanitaire
En moyenne, cinq produits phytosanitaires sont encore autorisés sur le marché chaque année dans le monde. Les nouveaux développements sont exigeants, longs et coûteux. Il faut aujourd'hui plus de 12 ans entre la recherche d'une substance appropriée et l'autorisation du produit prêt à être commercialisé. Les coûts s'élèvent à plus de 300 millions de dollars américains. Chaque nouveau produit phytosanitaire doit répondre à des exigences strictes. Les procédures d'autorisation des produits phytosanitaires sont comparables à celles des nouveaux médicaments.

Triazole dans le lac Léman : les autorités lèvent l'alerte
À la fin de l'été 2025, la nouvelle a fait sensation : la substance 1,2,4-triazole, un composé chimique utilisé dans diverses applications, a été détectée dans l'eau potable du lac Léman. Aujourd'hui, les cantons de Genève, Vaud et Valais donnent le feu vert : l'eau peut être bue sans crainte.

Faits mondiaux sur l’alimentation et l’agriculture
Nous ne pourrons ménager nos ressources et garantir une alimentation saine et abordable à une population de plus en plus nombreuse qu’en misant sur les progrès techniques et les produits phytosanitaires.

Pesticides dans les smoothies verts
Après les innombrables recettes de biscuits de Noël, de rôtis de fête et de cocktails, viennent maintenant les conseils pour maigrir, se détoxifier et s’embellir. La plupart relèvent du pur non-sens.

Toxines naturelles : un risque sous-estimé dans notre alimentation
Des aliments sûrs ne vont pas de soi. Alors que les substances chimiques sont souvent au centre des critiques, la réalité montre que les principaux risques pour notre sécurité alimentaire sont d’origine naturelle. Les récents rappels de produits destinés à l’alimentation infantile illustrent à quel point les toxines bactériennes ou les moisissures peuvent être insidieuses.

Avec le thé, malade plutôt que mince
Les produits phytosanitaires font souvent l’objet de critiques publiques. On oublie cependant que les substances naturelles présentes dans les tisanes et les compléments alimentaires peuvent également avoir des effets sur la santé.

